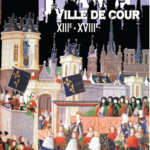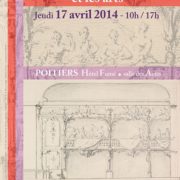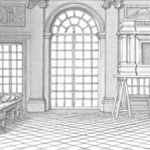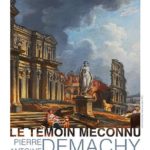Colloque – Paris, ville de cour (XIIIe-XVIIIe s.)
_ Les études sur la cour de France ne manquent pas, pourtant,
peut-être parce qu’elle reste longtemps itinérante et que ses membres
se recrutent à travers tout le royaume, les historiens s’intéressent
rarement au cadre urbain de ses séjours, et en particulier à Paris. La
cour semble être une institution hors de l’espace, alors que Paris,
« cour du royaume », s’impose de plus en plus comme son centre de
gravité.
Ce colloque Paris, ville de cour vise à réconcilier l’histoire
de la cour avec l’histoire urbaine. Il est donc consacré à l’étude des
relations entre la cour de France et la ville de Paris, du Moyen Âge
au XVIIIe siècle, en prenant en compte leurs dimensions politiques,
sociales, culturelles, artistiques et économiques. Le mot « cour »
est ici entendu au sens étroit des gens de cour qui sont dans la
proximité du souverain, et qui le suivent dans ses pérégrinations,
par opposition aux serviteurs de l’Etat qui sont fixés à Paris par les
institutions centrales de la monarchie.
Colloque international organisé par Boris BOVE (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis), Murielle GAUDE-FERRAGU (Université Paris 13 Nord), Cédric MICHON (Centre de Recherches Historiques de l’Ouest – Le Mans).
Informations pratiques :
Auditorium du Petit Palais
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris.
Métro : lignes 1 et 13, station Champs-Elysées Clémenceau
RER : ligne C, station Invalides ;
Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93.
Vélib’-Autolib’ : Avenue Dutuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contact : boris.bove@univ-paris8.fr