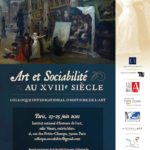_ À la lueur des recherches menées depuis ces vingt dernières années, la notion de sociabilité a fait l’objet d’un débat utile permettant un nouvel examen des changements politiques, sociaux et culturels qui eurent lieu au XVIIIe siècle. Les travaux de Daniel Roche, Dena Goodman, Daniel Gordon, Antoine Lilti, entre autres, ont démontré que la sociabilité est un concept fécond et commun aux différentes disciplines que sont la sociologie, la philosophie et l’anthropologie. Au XVIIIe siècle, l’Encyclopédie a défini le terme de la sorte : « La sociabilité est cette disposition qui nous porte à faire aux hommes tout le bien qui peut dépendre de nous, à concilier notre bonheur avec celui des autres, & à subordonner toujours notre avantage particulier, à l’avantage commun & général » (Louis de Jaucourt, « Sociabilité », Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers…, Paris, Briasson, 1751-1765, t. XV, p. 251). Ainsi, la notion est présentée comme un concept abstrait qui rend compte du désir de voir chaque homme participer activement à la vie de la société. Elle est liée, à l’époque, de manière complexe, à la notion de commerce, pratique sociale qui définit tous les modes de communication et d’échanges réciproques. La sphère publique émergente, composée de lieux comme les académies, les salons littéraires ou bien les loges maçonniques, a constitué la scène sur laquelle se sont joués de tels échanges. La publication de Thomas Crow, Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris, a incité les historiens de l’art à comprendre le rôle des artistes dans la sphère publique. Les études qui en ont découlé ont alors favorisé une approche monographique s’intéressant à la reconstruction de l’histoire d’un artiste, d’un salonnier ou d’un collectionneur, mais elles ont fait abstraction du rôle que les œuvres d’art ont joué dans les systèmes plus larges d’échanges et de pratiques sociales.
Ce colloque a pour but d’analyser la sociabilité dans le monde artistique du XVIIIe siècle à travers le prisme des pratiques sociales. En examinant les pratiques sociales des artistes, des amateurs, des critiques, des salonniers, etc., nous tenterons de comprendre les échanges sociaux et les réseaux formés non seulement par le commerce des objets matériels à travers l’étude des collections, du marché de l’art et des expositions, mais aussi par le commerce des idées à travers l’étude des écrits sur l’art et de l’art de la conversation. Ainsi, on peut s’interroger sur le rôle qu’ont joué les pratiques sociales au sein de la sphère publique dans l’évolution de la production artistique et des échanges matériels, économiques et verbaux.
Informations pratiques
Du 23 au 25 juin à l’Institut National d’Histoire de l’Art, Salle Vasari, entrée libre.
6, rue de Petits-Champs
75002 Paris
Voir le programme.