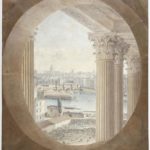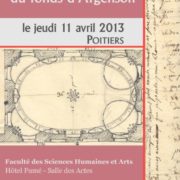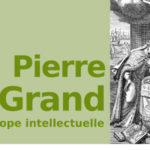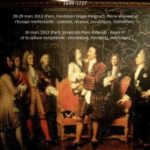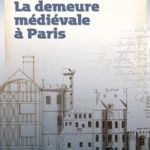Dédiées à un large public, les Rencontres des Gobelins sont des rendez-vous hebdomadaires durant lesquels se partagent les connaissances actuelles
de l’histoire de l’art et des activités du Mobilier national et des manufactures
nationales : tapisseries des Gobelins et de Beauvais, tapis de la Savonnerie
et dentelles du Puy et d’Alençon.
Pour ce semestre, deux pistes sont explorées : un métier de la décoration
(l’art du tapissier) et une question esthétique (le décoratif).
Rencontre 1 : un métier
L’art du tapissier et l’étoffe d’ameublement (XVe-XIXe siècles)
Sous la direction scientifique de Jean-Jacques Gautier et Xavier Bonnet
Acteur essentiel du décor de la demeure, l’art du tapissier reste un domaine de l’histoire des arts décoratifs encore mal connu et peu étudié. Au travers d’une approche chronologique s’étendant du Moyen-Age au XIXe siècle, ces rencontres avec des spécialistes se proposent d’explorer
les différents aspects de cette profession (techniques, stylistiques, sociales, économiques…) dans une approche pluridisciplinaire rassemblant tapissiers, historiens et historiens de l’art de différents horizons (universitaires, conservateurs, chercheurs indépendants).
— mardi 5 février
Meubler les demeures royales (XVIIIe siècle – 2)
Xavier Bonnet (Atelier Saint Louis) :
Les tapissiers du Roi.
Yves Carlier (château de Versailles) :
Les « boutiques » de tapissiers des maisons royales.
— mardi 26 février
Créer et copier (XIXe siècle)
Manuel Charpy (CNRS/IRHIS Lille III) :
Du tapissier au tapissier-décorateur : la naissance des styles.
Agathe Le Drogoff (EPHE) :
Les innovations brevetées par les tapissiers dans la première moitié du XIXe siècle.
— mardi 2 avril
Transmettre un savoir-faire (XIXe siècle)
Aagje Gosliga (historienne de l’art) :
Le Manuel du Tapissier (1830) d’Athanase Garnier : une oeuvre curieuse dans son temps.
Jehanne Lazaj (Mobilier national) :
Le magasin des matières premières du garde-meuble royal, impérial et de la République, ressource inépuisable des tapissiers.
— mardi 23 avril
Réfection, restauration, conservation
Vincent Cochet (château de Fontainebleau) :
Les restaurations au château de Fontainebleau.
Xavier Bonnet (Atelier Saint Louis) :
Perspectives : vers une histoire de l’art du tapissier ?
Rencontre 2 : une esthétique
Le décoratif en question. Regards croisés
Sous la direction scientifique de Marc Bayard et Christophe Henry
Le décoratif est une notion contemporaine – l’adjectif ne trouve vraiment sa place dans les dictionnaires qu’après 1800, et parler du décoratif plutôt que de l’ornement ou du décor est un usage qui ne s’impose qu’avec le XXe siècle. Pourtant, le décoratif recouvre un vaste champ de significations qui le fait préférer à décor, ornement ou décoration.
Si ces trois notions renvoient à des matérialités assez précises, le décoratif relie l’objet d’art à l’univers de la signification, le monde des
métiers d’art à celui des intentions culturelles plus larges. Ces rencontres pluridisciplinaires interrogent cette notion au regard de la question des ensembles mobiliers et de l’esthétique des arts décoratifs du XVIe au XIXe siècles.
— mardi 12 février
Le décoratif et les fonctions des arts du décor (XVIIIe siècle)
Christophe Morin (Université de Tours) :
L’ordre rustique. Un décor signifiant ?
Jörg Ebeling (Centre allemand d’histoire de l’art) :
Reconstituer l’esprit du décor : l’exemple de l’Hôtel de Beauharnais.
Modérateur / Patrick Michel (Université Lille III)
— mardi 19 mars
Le décoratif et la culture des apparences (XVIIIe siècle)
Christophe Henry (Groupe Histoire Architecture Mentalités Urbaines) :
Couvrez ce sens que je ne saurais voir. La peinture française du XVIIIe siècle est-elle vraiment décorative ?
Anne Perrin-Khelissa (Université catholique de l’Ouest, Angers) :
Le décor identitaire. Les palais de Gênes au XVIIIe siècle.
Modérateur / Marc Bayard (Mobilier national)
— mardi 9 avril
Décor et décoratif : fonctions et statuts au XIXe siècle
Jean-Jacques Gautier (Mobilier national) :
L’objet mobilier et le décor comme accessoires romanesques dans l’oeuvre d’Honoré de Balzac.
Arnaud Denis (Mobilier national) :
Un remeublement sous le Second Empire : les appartements Louis XIII et Louis XV à Fontainebleau.
Sylvie Legrand-Rossi (Les Arts Décoratifs / musée Nissim de Camondo) :
Le musée Nissim de Camondo ou « la reconstitution artistique d’une demeure du XVIIIe siècle » au début du XXe siècle.
Modérateur / Christophe Henry (Groupe Histoire Architecture Mentalités Urbaines)
— mardi 14 mai
Le décoratif et les arts décoratifs au XIXe et XXe siècles
Odile Nouvel (Les Arts Décoratifs, Paris) :
Le décoratif mis en abîme : collections et period rooms dans les musées.
Laura Clair (historienne de l’art) :
Une science du décor muséal ? Principes et finalités de l’accrochage
des peintures italiennes au musée du Louvre au XIXe siècle.
Modérateur / Dominique Jarrassé (Université Bordeaux III)
Autres activités
__
Exposition Gobelins par Nature. Eloge de la Verdure (XVIe – XXIe siècles)
Galerie des Gobelins
9 avril 2013 / janvier 2014
Commissariat / Marie-Hélène Massé-Bersani
Exposition Carte Blanche à Eva Jospin
Salon carré de la Galerie des Gobelins,
jusqu’au 22 septembre 2013.
__
Un programme de recherche L’histoire des Garde-Meubles en Europe (XVIe – XIXe siècles)
Mise en place d’un programme de recherches sur plusieurs années visant à écrire l’histoire des Garde-Meubles dans les cours européennes de la Renaissance au XIXe siècle.
Informations pratiques
> les mardis de 17h à 19h
42 avenue des Gobelins 75013 Paris
www.mobiliernational.fr
entrée libre et gratuite
> Pour toute information sur Les Rencontres des Gobelins, contacter Valérie Ducos
valerie.ducos@culture.gouv.fr
> programme des Rencontres des Gobelins